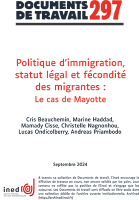Les Espagnols émigrent à nouveau vers la France et le Royaume-Uni : qui sont-ils et pourquoi ?
Population et Sociétés
n° 629, Janvier 2025
https://doi.org/10.3917/popsoc.629.0001
Universisté de Granada
Université d’A Coruña
Université d’A Coruña
Les départs d’espagnols vers principalement le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont en hausse et se maintiennent aujourd’hui à des niveaux élevés. Deux types de profils ressortent : les immigrés ayant acquis la nationalité espagnole qui ont été particulièrement touchés par la crise économique de 2008 et tentent leur chance dans un autre pays d’Europe et les jeunes natifs espagnol.es, souvent qualifiés, qui perçoivent dans la libre mobilité européenne une opportunité de carrière professionnelle.
émigration, immigré, migration, solde migratoire, crise, Espagne, France, Europe, Royaume-Uni, Allemagne
Table of contents
- Appendix A Références
1.
La France a longtemps accueilli beaucoup d’Espagnol·es. En 1968, ils constituaient la première nationalité étrangère. Les flux de migrants en provenance d’Espagne se sont ensuite réduits avec le développement économique du pays. Aujourd’hui, les départs d’Espagnol·es vers d’autres pays d’Europe ont repris. Les auteurs 1décrivent ces flux et les profils de ces nouveaux émigré·es espagnol·es.
1.1. L’Espagne, un pays d’accueil au tournant des deux siècles
Au cours du xxe siècle, l’Espagne était un pays d’émigration avec différentes vagues de départs principalement vers la France et d’autres pays européens comme l’Allemagne et la Suisse. À la fin du siècle, en 1999, un solde migratoire positif, c’est-à-dire avec davantage d’arrivées sur le territoire que de départs, a été enregistré pour la première fois. Dans les années suivantes, l’Espagne est devenue la principale destination des flux migratoires mondiaux vers l’Union européenne. Entre 1999 et 2007, la proportion d’étrangers sur le sol espagnol est ainsi passée de 2 % à 12 % 2.
En 2008, l’Espagne a connu une crise économique qui s’est étendue sur plusieurs années et le solde migratoire s’est à nouveau modifié : les entrées sur le territoire ont diminué tandis que les départs ont augmenté : des groupes d’immigrés sont retournés dans leur pays d’origine, d’autres ont rejoint d’autres pays (on parle de remigrations) et des natifs d’Espagne ont quitté le pays. C’est le retour de l’émigration espagnole. Pendant trois ans, le solde migratoire est à nouveau négatif (2013-2015) avec davantage de départs que d’arrivées sur le territoire espagnol. Même s’il est redevenu positif ensuite, les sorties du territoire espagnol restent plus élevées que dans les années précédant la crise. Ce rebond récent de l’émigration en provenance d’Espagne ou d’autres pays du sud de l’Europe est visible en France : en 2023, un quart des immigrés originaires d’Espagne ou d’Italie résidant en France sont arrivés dans les dix dernières années [1].
L’objectif de cet article est d’analyser l’évolution, les principales caractéristiques sociodémographiques et les motivations de l’émigration espagnole récente à partir de différentes sources de données (voir encadré). Il se centre sur les ressortissants espagnols, qu’ils soient nés en Espagne ou nés à l’étranger et naturalisés espagnols.
1.2. Des départs d’Espagne plus fréquents depuis la crise de 2008
L’Institut National Espagnol (INE) de la Statistique nous fournit des données sur les Espagnols vivant à l’étranger. Cette source, basée sur les inscriptions dans les consulats des pays de destination, bien que présentant des limites (voir encadré), renseigne sur les caractéristiques des émigrés comme leur pays de naissance, sexe et âge. Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont les trois principaux pays de destinations en Europe des Espagnols depuis 2008 (figure 1). Les départs croissent jusqu’en 2016 vers la France et le Royaume-Uni, et jusqu’en 2015 vers Allemagne. Au cours de la période 2008-2013, l’Espagne a connu plusieurs trimestres de récession économique avec un taux de chômage qui atteint 27 % au premier trimestre 2013. Les sorties se sont ensuite stabilisées à des niveaux élevés de 2016 à 2021 mais bien supérieurs à ceux observés lors des premières années de la crise économique, malgré l’amélioration de la situation économique. En 2021, le Royaume-Uni est, de loin, le principal pays de destination des émigrés espagnols avec des flux annuels de 13 500 personnes, suivi de la France avec 8 500 personnes, puis l’Allemagne (6 000 personnes). Pendant cette période, la structure de la population des flux d’émigrés espagnols a évolué. La proportion de ceux nés à l’étranger a augmenté progressivement et atteint 42 % en France et au Royaume-Uni en 2021. Parmi eux, trois origines se démarquent particulièrement pour toute la période : le Maroc (24,7 %), la Colombie (10,0 %) et l’Équateur (8,8 %). Il faut rappeler que pendant les années de crise économique, le nombre de demandes d’acquisition de la nationalité espagnole 3 a connu une forte croissance [2].
1.3. Une diversité de profils
Les profils d’émigrants espagnols sont plus diversifiés que ceux des vagues précédentes de départs, notamment durant l’émigration économique des années 1960 et 1970. Les flux de migrations sont nettement moins masculins. Au sein de la population émigrante née en Espagne, les femmes sont majoritaires dans les départs vers le Royaume-Uni et la France en 2021 (figure 2). Les femmes sont toujours plus nombreuses parmi les émigrés espagnols nés en Espagne dans les trois pays de destination que ceux nés à l’étranger. L’émigration d’Espagnols naturalisés est plus masculine notamment vers la France. D’une part, les emplois détruits pendant les années de crise économique en Espagne étaient dans des secteurs professionnels plus masculins, avec par exemple l’effondrement du secteur du bâtiment. D’autre part, les migrants naturalisés espagnols qui ont migré vers la France sont en grande proportion nés au Maroc (49,4 %) et sont majoritairement des hommes (69,11 % d’entre eux).
Si l’âge moyen à l’émigration se situe entre 28 et 35 ans, il existe des disparités d’âges selon le pays de destination et le lieu de naissance (figure 3). Dans l’émigration de natifs espagnols vers la France, le groupe 18-34 ans est le plus important jusqu’en 2014, puis c’est celui des moins de 18 ans 4. La situation des Espagnols naturalisés est différente : le groupe des 35 à 49 ans est le plus important depuis 2009. L’émigration vers le Royaume-Uni est plus jeune à la fois pour les natifs d’Espagne et les Espagnols nés hors d’Espagne, tandis que celle vers l’Allemagne est un peu plus âgée.
Les personnes naturalisées ont donc émigré d’Espagne à des âges plus avancés du cycle de vie. Ils sont arrivés en Espagne à un jeune âge pendant les années du boom immobilier, ce qui leur a permis d’occuper un emploi pérenne et obtenir la nationalité espagnole. Avec le début de la crise, leur situation économique s’est dégradée et ils ont choisi d’entreprendre une nouvelle migration. Les personnes nées en Espagne sont plus jeunes et plutôt diplômées, avec des projets de débuter leur carrière dans un autre pays pour se donner davantage de chances qu’en Espagne.
Les données sur le niveau d’instruction ne sont disponibles qu’à partir de 2019. Elles montrent, pour la période 2019-2021, des différences entre les deux groupes d’émigrants espagnols : la proportion de natifs d’Espagne ayant fait des études supérieures est beaucoup plus élevée que celle des Espagnols naturalisés. Ces données sont en accord avec les enquêtes annuelles de recensement françaises de l’INSEE selon lesquelles 56 % des personnes nées en Espagne arrivées en France depuis 2012 ont fait des études supérieures [3].
1.4. Pourquoi quitter l’Espagne ?
Pourquoi l’émigration espagnole a-t-elle récemment repris ? Cela tient en partie aux conséquences des années de la crise économique. L’Espagne a un marché de travail historiquement faible, qui a souffert très intensément des effets de la crise économique de 2008-2014. Au cours de ces années, le taux de chômage a augmenté jusqu’à atteindre son pic au premier trimestre 2013 (27 %). Il est resté supérieur à 20 % jusqu’au deuxième trimestre 2016. Les valeurs étaient encore plus élevées pour les jeunes (y compris les plus instruits) et pour la population d’origine immigrée. Ces dernières années, le taux de chômage global est proche des niveaux d’avant la crise, mais reste largement supérieur à la moyenne de l’Union européenne.
En ce qui concerne les jeunes diplômés, le manque d’opportunités professionnelles est à la base de leur motivation à partir. Des ingénieurs, architectes et personnels de santé cherchent à démarrer leur carrière ou à lui donner un coup de pouce en dehors d’Espagne. Les projets sont divers et s’inscrivent très souvent comme une « migration liquide » [4], en référence à son caractère individuel, flexible et réadaptable, qui échappe souvent à un projet initialement bien défini. Parfois, les projets sont planifiés à court terme et l’émigration est vue comme une période d’apprentissage dont on pourra tirer bénéfice au retour en Espagne.
Dans le secteur de la santé, le cas des infirmières et des kinésithérapeutes en est une illustration. On estime qu’en 2016, il y avait plus de 10 000 infirmières espagnoles exerçant dans un autre pays que l’Espagne, dont 70 % environ au Royaume-Uni et 18 % en France 5. Cette forte présence au Royaume-Uni peut expliquer la féminisation des flux, puisqu’il s’agit d’un métier dans lequel les femmes sont largement majoritaires. Cette tendance change après le Brexit et certaines infirmières reviennent en Espagne, si bien que le stock d’infirmières espagnoles au Royaume-Uni a diminué. En 2021, le nombre d’infirmières espagnoles à l’étranger n’était plus que d’environ 6 500, dont 50 % au Royaume-Uni. D’autre part, la France est le pays favori d’émigration des kinésithérapeutes espagnols. Ils représentent 23,4 % des professionnels étrangers dans ce métier, et la deuxième nationalité après la Belgique, et environ 9 % de l’ensemble de la profession 6. La raison de ces jeunes n’est pas tant le chômage en Espagne que les meilleures conditions de travail en France, où la sécurité sociale couvre les séances de patients, ce qui n’est pas complètement le cas en Espagne. La sécurité sociale espagnole ne couvre que partiellement les sessions de physiothérapie avec des restrictions et des retards de remboursement pour les cas non urgents. Les conditions pour travailler dans le secteur public sont donc plus difficiles en Espagne.
Pablo est un jeune originaire de Bilbao de 30 ans émigré à Nice en 2014. Après avoir terminé ses études de physiothérapie en Espagne, il n’a travaillé que quelques mois dans le secteur privé puis a décidé d’émigrer en France :
« Parce que c’était beaucoup plus simple ici, il y a beaucoup d’offres d’emploi. Ce que je ne vais pas faire, c’est dénigrer mon travail. Je sais que j’ai beaucoup d’amis qui travaillent en Espagne pour très peu d’argent... Ayant le diplôme que nous avons, nous ne sommes pas obligés de travailler avec les conditions de travail actuelles en Espagne. Si j’étais resté en Espagne, je n’aurais pas eu l’occasion d’en apprendre davantage, j’aurais eu un travail, enfin, dans une maison de retraite privée... ici [en France], nous avons des opportunités au niveau professionnel ».
Marouane, né à Tétouan au Maroc, a émigré en Espagne en 1991 à l’âge de 19 ans, où il a occupé plusieurs emplois, notamment dans l’hôtellerie. En 2011, il acquiert la nationalité espagnole. Il dit subir les effets de la crise depuis 2008. En 2012, alors que sa situation professionnelle se dégrade, la première option est de retourner au Maroc. Il y reste un an puis retourne en Espagne. Mais sa situation ne s’améliore pas et il craint, en outre, de perdre la sécurité sociale. C’est alors qu’il décide de partir en région parisienne pour chercher du travail dans l’hôtellerie. Il a 40 ans :
« J’ai décidé d’aller en France parce qu’il est arrivé un moment où mon chômage et les aides se sont épuisés. Tu commences à chercher du travail pour survivre et tu ne trouves même pas un emploi pour payer le loyer. Il faut passer à autre chose. Retour au Maroc ? Il faut repartir de zéro avec l’âge qu’on a. Il y avait une alternative, j’avais obtenu un passeport espagnol. Une alternative d’un autre pays où ils te proposent du travail. C’est comme une roue qui ne s’arrête pas. C’est comme un marathon dès la naissance : on commence à courir et on court encore, il n’y a pas de pause, ni de temps pour réfléchir... ».
1.5. Les Espagnols en France : avant la crise et maintenant
Le registre des Espagnols à l’étranger permet de comparer la structure de la population espagnole dans un pays de destination comme la France à des moments différents, juste après la crise économique espagnole de 2008 et en 2023 (dernière année disponible), grâce à des pyramides des âges (figure 4). Cette population est composée des émigrants de différentes vagues migratoires et origines, ainsi que de leurs descendants possédant la nationalité espagnole. La pyramide des Espagnols en France montre une augmentation du poids des moins de 25 ans entre 2009 et 2023, ainsi que l’avancée en âge des anciens émigrés restés en France dans la catégorie des 85 ans et plus. La partie inférieure témoigne de l’arrivée aux âges actifs des nouveaux émigrants et de leur descendance en France.
1.5.1. Encadré. Des données de nature différente
Cette recherche s’appuie sur l’analyse de deux sources de l’Institut National Espagnol (INE) de la Statistique à partir des inscriptions dans les consulats. Une première source enregistre les flux d’entrées et sorties de personnes de nationalité espagnole (Estadística de variaciones residenciales, Statistiques des variations résidentielles) entre 2008 et 2021. Lorsqu’une personne émigre à l’étranger, elle doit s’inscrire au consulat correspondant. Bien qu’il s’agisse d’une procédure obligatoire, son non-respect n’est pas poursuivi par les autorités espagnoles, de sorte qu’il est sans doute courant que l’inscription soit omise ou retardée(a). Comme l’ont montré d’autres études [5], les données sur l’émigration selon le pays d’origine sous-estiment généralement donc fortement les flux d’émigration réels. Malgré ces limites, les données donnent les grandes tendances sur les flux de départs d’espagnols.
La deuxième source est le registre des Espagnols à l’étranger (PERE, Padrón de españoles residentes en el extranjero) qui renseigne sur le stock d’Espagnols vivant à l’étranger. Il inclut non seulement les espagnols qui ont émigré d’Espagne, mais aussi leurs descendants (les enfants) dans les pays destinations ainsi que les Espagnols qui sont passés par un autre pays avant d’arriver dans l’actuel pays de résidence (réémigrés).
Enfin, des entretiens qualitatifs ont été réalisés entre 2018 et 2022 dans trois des principaux pays de destination des émigrés espagnols (France, Royaume-Uni et Allemagne) afin de mieux comprendre les motivations et les projets migratoires. L’échantillon a été d’abord sélectionné selon des critères (sexe, niveau d’éducation, pays de naissance, etc.) pour diversifier les profils puis par la méthode « boule de neige » : les participants proposent les coordonnées d’autres participants. Nous mettons ici en avant les deux profils les plus courants selon l’analyse quantitative : les jeunes Espagnol⋅es ayant fait des études supérieures et les immigré⋅es ayant acquis la nationalité espagnole.
-----
(a) L’enregistrement auprès du consulat du pays où l’on vit présente certains avantages comme permettre l’obtention ou le renouvellement de son passeport sur place, pouvoir voter depuis l’étranger mais aussi des inconvénients comme la perte éventuelle de droits sociaux et d’accès aux soins en Espagne.
Appendix A Références
-
[1] Tanneau, P. (2024). En 2023, 2,4 millions d’immigrés nés en Europe vivent en France. Insee première, nº 2011. https://www.insee.fr/fr/statistiques/8236359
-
[2] Martínez de Lizarrondo Artola, A. (2016). Naturalizaciones en España: indicador de integración y estrategia frente a la crisis. Migraciones, 39, 3–37. https://doi.org/10.14422/mig.i39y2016.001
-
[3] Brutel, C. (2014). Les immigrés récemment arrivés en France: une immigration de plus en plus européenne. Insee première, nº. 1524. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281393
-
[4] Engbersen, G. (2012). Migration transitions in an era of liquid migration. In Okólski, M. (dir.) The Continent of Immigrants: Trends, Structures and Policy Implications. Amsterdam University Press, 91-105. https://doi.org/10.1515/9789048517275-005
-
[5] De Beer, J., Raymer, J., Van Der Erf, R., Van Wissen L. (2010). Overcoming the Problems of Inconsistent International Migration data: A New Method Applied to Flows in Europe. European Journal of Population, 26, 459–481. https://doi.org/10.1007/s10680-010-9220-z
Cette recherche a été financée dans le cadre d’un projet soutenu par le Ministère espagnol de l’Économie et de la Compétitivité (PID2019-105041RA-I00) et d’une bourse de mobilité à l’INED dans le cadre du Programme José Castillejo (Ministère de l’Innovation, de la Science et des Universités d’Espagne).
INE, Instituto Nacional de Estadística (institut national statistique espagnol).
Selon le Ministère de l’Immigration et de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, entre 2009 et 2023, 1 891 732 immigrés ont obtenu la nationalité espagnole.
Il est possible que soient inclus ici à la fois les enfants d’immigrés espagnols naturalisés, déjà nés en Espagne, et les enfants d’Espagnols de naissance.
Données extraites du Conseil général des écoles officielles d’infirmières d’Espagne
Données extraites de l’Observatoire de la démographie du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (2022).
Citer l’article
Alberto Capote Lama, Sandra López Pereiro et Belén Fernández Suárez (2024). Les Espagnols émigrent à nouveau vers la France et le Royaume-Uni : qui sont-ils et pourquoi ?, Population & Sociétés, n° 629. https://doi.org/10.3917/popsoc.629.0001
 Cet article peut être reproduit sur papier ou en ligne gratuitement en utilisant notre licence Creative Commons.
Cet article peut être reproduit sur papier ou en ligne gratuitement en utilisant notre licence Creative Commons.